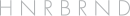
Henri Barande est de ceux que la création pousse aux extrêmes. Son travail entamé et poursuivi avec une détermination quasiment compulsive depuis son enfance, demeure non seulement inconnu du public et des institutions, mais une grande part en a été anéantie délibérément par ses soins. D’une pratique méticuleusement dédiée à l’élaboration d’un monde de formes et de figures modelées en miniature, il ne reste aujourd’hui que des vestiges soigneusement soustraits au regard des autres. C’est pourtant de cet acte destructeur que surgit, depuis une quinzaine d’années, une suite étourdissante d’images peintes, monumentales, suspendues, à la fois distantes et absorbantes, avivées de couleurs d’un raffinement oublié, jouant sans freins de la dialectique entre l’abstraction et la figuration.
En dépit de son acharnement à produire, de la prolixité généreuse de son travail, toute l’entreprise d’Henri Barande confine à l’anonymat. Ses œuvres ne portent ni de titres ni de nom d’auteur. Elles ne sont pas à vendre ; elles sont hors système. Artiste à part entière, il s’est donné les moyens de se libérer des contraintes matérielles, de se consacrer sans compromis à sa tâche, de disparaître littéralement derrière son œuvre, de ne vivre que par elle. Ni plus ni moins absent de la scène. Il s’était d’ailleurs fixé une règle : ne pas montrer son travail; non seulement pour éviter le regard ritualisé des autres, mais pour mieux s’enfermer avec lui, créer un face-à-face dépourvu de feinte et de complaisance et même pouvoir le détruire à sa guise, demeurer libre, se protéger de toute curiosité à son endroit. Or ce n’est que très récemment que, prenant soudainement conscience de la portée de l’expérience que sa production provoque, mesurant la singularité de son retentissement, il a rompu l’exigence de ce pacte intime et tacite.
Il y avait jusqu’alors dans son attitude quelque chose qui s’apparentait à une décision suicidaire, une réclusion au profit de l’édification âprement poursuivie d’une œuvre. La chose est assez rare pour qu’on s’y arrête. C’est la raison de cette exposition, ici dans les galeries d’exposition de l’Ecole des beaux-arts, où elle ne manquera pas de poser la question de la légitimité d’une œuvre solitaire, muette, normalement vouée à l’invisibilité et à l’oubli, sans le soutien des ressorts habituels de la reconnaissance, sans la complicité de la communauté professionnelle. Car cette œuvre, par son processus et son évolution, interroge non seulement le fonctionnement institutionnel mais encore le système de l’art dans son entier. Il n’est pas anodin ni sans doute inutile que ce lieu voué à toutes les formes, à toutes les expressions de la création, porte aujourd’hui à la connaissance du public une telle aventure. L’une des particularités de son auteur est de recourir aux procédés technologiques contemporains les plus sophistiqués pour les infuser dans le domaine de la peinture et de son histoire, usant en particulier du procédé classique de la citation de motifs connus mais réinterprétés par le filtre de l’image numérique, privilégiant l’exécution manuelle mais en la neutralisant par le report de la projection. C’est ainsi qu’il en vient à produire des images qui tiennent paradoxalement de l’unicum et du multiple, qui superposent dans un raccourci équivoque et sibyllin l’original à la reproduction, le prototype à sa dimension sérielle. Ce faisant il prend l’art de son temps à contre-pied, il le piège sur son propre terrain, avec les mêmes moyens, avec les mêmes références conceptuelles.
Cruellement séparé de son pays d’origine, l’Algérie, qu’il chérit toujours, ayant fait la douloureuse expérience de la folie d’un proche, Henri Barande considère qu’il vit dans un espace qui prolonge une mort pour lui accomplie et que son travail n’est que la partie miraculeusement émergée d’une existence considérée depuis son antériorité, que son œuvre en est la forme survivante. En la regardant, on songe immanquablement à celle de Maurice Blanchot, au silence qui en est la finalité, à l’instance de la mort qui la féconde. Ses images distancées, articulées en fragments, comme un long récitatif sans fin, sont à l’exemple des méditations menées inlassablement sur les thèmes de la neutralité, de l’absence, de la voix blanche mis au jour par l’écrivain. Elles contribuent à l’édification d’une immense figure, celle du tombeau, ce mot que l’artiste aimerait voir accolé à tout ce qui émane de lui. Paradigme central de la pensée de cet absent (comme il aime à se définir lui-même) le tombeau n’apparaît pas chez lui sous la forme de la célébration tout à la fois funèbre, élégiaque et extatique, familière au monde baroque. Elle est plutôt celle que Mallarmé fera resurgir en maintes circonstances, en particulier après la mort de son fils, sous la forme d’un monument taciturne, d’une architecture fragilisée par une affliction inconsolable, d’une écriture fissurée par un deuil impossible.
Aujourd’hui, après ce naufrage, Henri Barande construit un récit monumental, altier, sorte d’ immense frise moirée de couleurs incandescentes et de sourds accents ténébreux, animée d’une scansion inexorable, d’un schéma répétitif, où alternent, dialoguent, s’entrecroisent, s’entrechoquent, comme dans les polyptiques, des motifs et des images avivées par les savantes procédures visuelles mises en œuvre par le peintre. C’est un monde à la fois raffiné, inquiet et dramatique, fait d’images désincarnées, vouées à la transparence du souvenir, dont les traits empruntent à un mélange paradoxal de Maniérisme, de Pop’Art et d’Hyperréalisme, mais immédiat, instantané, construit sur la force de l’impact du détail, de la citation, articulé en combinaisons iconographiques aléatoires qui font de tout accrochage, de toute exposition, une installation nouvelle.
On est à l’opposé de ce qui l’a précédé : des premiers gestes qui pétrissaient obsessionnellement la mie de pain mêlée au sable, forgeant en secret et par milliers les rudiments d’un univers qui dans le même temps réinventait la sculpture et refaisait malgré lui l’histoire du monde. On n’en découvre aujourd’hui que les restes, sauvés du désastre, comme un mobilier funéraire voué à l’enfouissement, énigmatique, où des formes apparaissent dans la perfection de leur naissance, dans la préciosité que leur donne leur longue traversée nocturne jusqu’à notre regard. Ce sont des sortes de reliquaires, faits à la fois de figures idéales et d’excentricités naturelles, de traces archéologiques ou d’humbles témoins des jours, minutieusement rangés, suggérant des agencements innombrables, infinis, témoignant d’un sens caché, d’une intentionnalité imperceptible qui les saturent d’une signification qui nous égare.
A première vue, rien de plus dissemblable que les sculptures et les peintures. A les observer de près cependant, leurs processus sont comparables. Les tombeaux qui contiennent aujourd’hui les restes de sa production antérieure sont des cabinets de curiosités miniatures. Leur hétérogénéité consubstantielle traduit la quête permanente de la pièce manquante, celle qui devait alimenter, poursuivre le discours que les autres avaient commencé. Elles marquent un même goût méticuleux pour la perfection plastique de formes minimales, les matières rares ou précieusement façonnées par le temps, elles exposent l’aisance avec laquelle elles jonglent avec les échelles, simulant le monumental aussi bien que l’infime. L’artiste se joue de l’ambiguïté entre les artifices de la nature et ceux du sculpteur, tantôt modeleur, tantôt fondeur, transmuant l’humble mie de pain en or. Mais il se joue surtout du principe d’aimantation, de tension ou de rejet, qui règle, comme par une alchimie secrète, la disposition des objets dans leurs boîtes. Ce propos, les images peintes l’articulent à leur façon, et en dépit de leur silencieuse retenue, leurs stratagèmes ne sont pas moins élaborés.
Derrière leur distance apparente, les images d’Henri Barande, témoignent d’une inclination marquée pour le cadrage et le fragment. Elles se plaisent aux subterfuges pratiqués de tout temps par les artistes qui voulant défier les conditions ordinaires de la vision humaine, restituent la réalité avec le regard hypertrophié, infaillible, des instruments d’optique. Ayant vécu sa jeunesse au milieu des restes de l’ancienne Carthage, habitué de ces sortes d’ au-delàs que sont les ruines, Henri Barande navigue aussi familièrement dans les méandres de sa mémoire : l’image pixélisée contemporaine se superpose aujourd’hui naturellement au souvenir des mosaïques du musée du Bardo, la puissance imagée de ces tapis et de ces tentures de pierre cristallisée à la concision des figures et des motifs qui hantent ses tableaux, et leur splendeur chatoyante la lente approche, exigeante et laborieuse, de l’exactitude du timbre chromatique qui leur donnera leur fascinante tonalité.
Le besoin de « liberté métaphysique », comme il le définit lui-même, conduit Henri Barande sur les chemins les plus escarpés de l’ascèse. Car « l’absent » qu’il est, veut simplement disparaître derrière son œuvre et signer par là son propre anéantissement. Le thème de la disparition, de la mort de l’auteur, central dans l’œuvre de Blanchot, Roland Barthes lui donnera plus tard dans un texte à propos de Balzac, intitulé « La mort de l’Auteur », une conclusion retentissante du même ordre: « la naissance du lecteur (on dira ici du regardeur) doit se payer de la mort de l’Auteur ». La neutralité revendiquée, en l’occurrence celle de l’écriture, c’est l’identité du « corps qui écrit » et qui, tout en la forgeant et lui donnant naissance vient, dans une parfaite osmose, s’effacer en elle. Il en va de même pour l’œuvre d’Henri Barande, qui clame aussi sa neutralité et l’absence de son auteur, qui revendique plutôt sa présence comme la preuve de sa mort et qui finit par se substituer entièrement à son créateur. Cet anonymat réclamé, cette mort dont il ne cesse de nous dire qu’elle est à prendre au pied de la lettre, c’est finalement la preuve de confiance la plus entière, la plus absolue que le peintre puisse accorder à son interlocuteur. Car en l’invitant à dépasser les protocoles habituels, à franchir l’obstacle de son retrait, il instaure les conditions d’un véritable tête-à-tête, libre de tout préjugé. Dès lors son œuvre se confond, fait littéralement corps avec lui, vient à l’incarner au-delà de toute convenance, au-delà de toute limite, au point qu’il n’y a plus d’écart, plus de différence entre l’auteur et son complice, celui qui regarde.
Mais Blanchot nous rappelle aussi que pour échapper, en quelque sorte, à la mort que l’on ne peut pas maîtriser, sur laquelle on est sans pouvoir, « qu’on atteint jamais », on peut préférer une mort volontaire. Le suicide est de ce fait une voie au terme de laquelle on est susceptible de trouver l’origine et le sens de l’œuvre, parce qu’il s’y joue le même risque, parce que l’une et l’autre font appel à une expérience de la même gravité, parce que « le pouvoir de mourir » évoqué par Blanchot est tout compte fait de même nature que celui auquel l’œuvre nous donne accès. Processus définitif, l’œuvre est comme le regard d’Orphée décidant de descendre vers Eurydice dans les Enfers, irréversible. Elle est la seule condition, le seul moyen qui permette d’atteindre ce qu’elle a pour objet de dissimuler en elle : le pouvoir et la souveraineté de la profondeur. C’est ce qu’a toujours compris Henri Barande. Pour lui ce fût là, de tout temps, le prix à payer.
Henry-Claude Cousseau, directeur des Beaux-Arts de Paris.